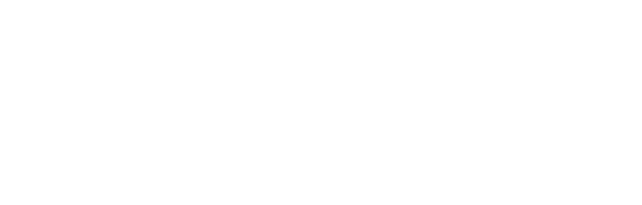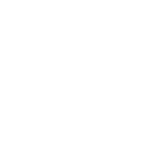L’interview de CHIARA BERSANI
FESTIVAL EVERYBODY au carreau du temple
Crédits photo : Alice Brazzit
LECTURE
15 min
DATE
PAR
Partager cet article
Artiste et performeuse italienne, Chiara Bersani développe une œuvre qui interroge la place des corps handicapés dans l’espace public et scénique. Son travail mêle création artistique et engagement politique, en proposant d’autres manières de penser le mouvement, la communauté et la présence.
Elle présente Sottobosco au Carreau du Temple pendant le Festival Everybody, les 18 et 19 février.
Peux-tu nous parler de ton enfance et de ton parcours artistique ? Comment ces premières années ont-elles façonné ton rapport au corps et au mouvement ?
Mon enfance est complexe, mais si je cherche une continuité avec mon travail artistique, elle commence par le fait que j’étais une enfant handicapée. J’ai grandi dans une petite ville italienne, dans une famille de fonctionnaires, avec peu de moyens mais un capital culturel solide. Mes deux parents étaient instituteurs, ce qui m’a permis de grandir dans un environnement socialement structuré et attentif. Pour un enfant handicapé, ce type de cadre est essentiel.
En Italie, depuis les années 1970, les enfants handicapés sont intégrés à l’école publique ordinaire. J’ai donc été scolarisée avec des enfants handicapés et non handicapés. Dans ce petit village, les mêmes personnes rencontrées à la maternelle sont restées mes amis jusqu’au collège.
Cela m’a donné un sentiment très fort de communauté, presque comme l’appartenance à une petite tribu. Le handicap n’était jamais perçu comme un problème individuel, mais comme une réalité qui concernait l’ensemble du groupe. L’identité se construisait de manière collective, jamais isolée.
Ce sentiment d’interdépendance continue aujourd’hui de nourrir mon travail, profondément ancré dans les relations, les collaborations et la pensée partagée.
Mon enfance a aussi été marquée par une forte médicalisation du corps. Pendant de nombreuses années, la volonté a été de l’améliorer, notamment au niveau de la marche, alors même que je savais que ce ne serait jamais ma manière naturelle de me déplacer.
La rencontre avec le théâtre a été décisive. Elle m’a permis de détacher mon corps de la logique de la réhabilitation et de l’amélioration permanente. J’y ai découvert qu’il existait d’autres façons de se mouvoir dans l’espace, au-delà des conventions sociales.
Cette première découverte, qui a été pour moi une véritable révolution, a fait naître un désir très fort de travailler avec le corps dans des espaces scéniques et performatifs. Car c’est là que le corps peut inventer sa propre grammaire du mouvement — chose rarement possible dans l’espace urbain et social.

LECTURE
5 min
DATE
PAR
Partager cet article
Quand as-tu compris que ton corps pouvait être non seulement un espace artistique, mais aussi un espace politique ?
J’ai développé très tôt une sensibilité politique, intimement liée à mon corps et à ma position dans le monde, sans doute aussi à cause de l’environnement dans lequel j’ai grandi.
Mais cette dimension est devenue pleinement explicite à travers ma pratique artistique.
En travaillant, en créant des performances, j’ai réalisé que de nombreuses expériences n’étaient pas nommées, ou qu’elles étaient décrites à travers un langage que je ne reconnaissais pas comme le mien. Il manquait quelque chose. Il y avait une forme de déformation.
J’ai alors compris que faire de l’art, c’était aussi produire de la culture.
Et façonner de la culture, c’est transformer le langage — l’hybrider, l’ouvrir, refuser ce qui n’y trouve pas sa place.
Ce qui était d’abord instinctif et brut est devenu, avec le temps, plus structuré, plus conscient.
Jusqu’à s’imposer comme un choix clair.
Aujourd’hui, mon travail est indissociable d’un engagement politique, notamment autour des droits des artistes handicapés. Mon corps n’est pas seulement un espace d’expression : c’est un lieu où le langage, le pouvoir et l’imaginaire sont constamment renégociés.

Dans tes performances, le mouvement n’est jamais une question de virtuosité, mais de présence et de résistance. Pourquoi ?
La virtuosité ne m’a jamais séduite.
Ni en danse, ni au cinéma, ni dans les arts visuels.
Elle est souvent associée à la maîtrise technique et à des idéaux de perfection très éloignés de mon expérience vécue en tant que personne handicapée. Cela ne signifie pas que les corps handicapés ne peuvent pas être virtuoses.
Ils le peuvent.
Mais mon propre rapport au handicap s’enracine ailleurs. Il se situe dans la liberté de désobéir aux règles, de saboter les normes, d’inventer d’autres critères de valeur.
Il y a là quelque chose de profondément anarchique, presque révolutionnaire.
Bien sûr, ce choix comporte un risque.
S’éloigner de la virtuosité peut être interprété comme un manque de discipline ou comme de l’approximation. Mais ce n’est pas ce qui m’intéresse.
Je crois profondément à la rigueur.
Je la cherche simplement ailleurs :
dans l’attention,
dans la présence,
dans l’intensité du regard,
dans le travail fragile et exigeant de construction d’une relation réelle avec le public.
Ce type de présence demande une précision extrême. Sans rigueur, on se perd.
Comment ton corps a-t-il façonné ta perception de l’espace et du temps ?
Je pense que c’est vrai pour tout le monde : nous appréhendons le monde à travers le corps. Le corps est notre premier et unique instrument de connaissance.
Nous pouvons essayer de l’oublier ou de le nier, mais nous ne pouvons pas y échapper.
C’est aussi pour cela que l’intelligence artificielle ne m’inquiète pas. Tant qu’elle n’a pas de corps, pas de peau, pas d’articulations, pas de souffle, pas de sens pleinement vivants, elle ne peut pas apprendre comme un être humain.
Pour moi, le temps a toujours été le temps dont mon corps a besoin.
Et l’espace a toujours été filtré par ma chair, mes os, mes muscles, mes articulations.
Je ne peux pas imaginer une autre manière de percevoir le monde.
Peut-être que celles et ceux dont le corps correspond plus facilement aux normes y pensent moins.
Ou peut-être pas.
« Je crois simplement que c’est cela, être vivant : avoir un corps et explorer le monde à travers lui.«
Peux-tu nous parler de Sottobosco ? Quels mots ou quelles images utilises-tu pour décrire cette pièce ?
Sottobosco est né pendant les confinements liés à la pandémie.
À ce moment-là, l’un des récits dominants était l’idée de « s’échapper » dans la nature — comme si le véritable problème avait été l’enfermement, et non la maladie, la mort ou l’effondrement des systèmes de santé publique.
Le « retour à la nature » était présenté comme quelque chose de poétique, de libérateur, d’horizontal. Depuis ma position de femme handicapée, j’ai immédiatement perçu à quel point ce récit était faux et violent.
Qui peut réellement aller vivre dans la nature ?
Les personnes fortes.
Les personnes en bonne santé.
Celles qui ne dépendent pas des soins, des dispositifs médicaux, des fauteuils roulants, des respirateurs.
Derrière cette image romantique se cachait une vision de la vie profondément verticale et excluante.
Sottobosco est né de cette colère, et d’une question simple et radicale :
que se passerait-il si un groupe d’enfants handicapés se retrouvait soudain seul dans une forêt, sans aides, sans protection ? Comment survivraient-ils ?
De cette question est née l’envie d’inventer une autre nature.
Une nature construite sur d’autres règles.
Une nature qui reconnaît le handicap comme faisant partie de la vie dès l’origine — et non comme une exception, ni comme une erreur.
Dans le monde de Sottobosco, le corps handicapé n’est pas quelque chose à adapter plus tard.
Il est le point de départ.

Dirais-tu que ce travail est un acte de résilience, de résistance ou de soin ?
Je ne décrirais pas ce travail avant tout comme un acte de résilience ou de résistance. Pour moi, il commence par le désir.
Pas un désir instinctif ou impulsif, mais un désir lucide, patiemment construit — façonné par l’étude, l’attention et le temps.
C’est comme si j’avais passé des années à écrire ce désir avec précision, en attendant le moment juste pour le laisser advenir.
Sottobosco porte quelque chose de l’ordre de la bénédiction, d’une invocation silencieuse. Mais c’est aussi une œuvre très concrète.
Quelque chose s’y produit réellement.
Je rencontre des personnes.
Nous passons du temps ensemble.
Nous travaillons, nous partageons des journées, nous construisons des processus qui restent souvent vivants pendant des années.
Parce que quelque chose advient, le désir devient progressivement un projet — une tentative de donner forme à ce que nous appelons de nos vœux.
Et ce que je cherche à construire, c’est un nouveau sens de la communauté : large, ouverte, fraîche, profondément collaborative.
Une communauté fondée sur une véritable interdépendance.
Pourquoi était-il important de revenir à l’enfance dans cette création ?
Au départ, ce retour à l’enfance était étroitement lié à la pandémie. Lorsque les confinements ont commencé, j’étais déjà adulte, avec une vie, une profession, une certaine stabilité. Et pourtant, j’étais profondément effrayée. Mes pensées se tournaient sans cesse vers les enfants.
J’imaginais ce que cela signifiait de grandir sans contact, sans temps partagé, sans autres corps à proximité. Pour moi, avoir grandi au sein d’une communauté avait été essentiel. Même durant de longues périodes passées à l’hôpital, je garde le souvenir des petites communautés d’enfants qui s’y formaient.
La communauté a toujours fait partie de mon enfance.
Pendant la pandémie, lorsque j’imaginais des enfants privés de cette expérience, ils se sont imposés au centre de ma réflexion.
Au début, Sottobosco était pensé comme un monde d’enfants dans la forêt.
Puis la réalité du travail artistique est intervenue.
Lorsque j’ai tenté de travailler avec des enfants handicapés, j’ai mesuré à quel point cela était complexe. Ils n’ont pas répondu à l’appel. Les conditions n’étaient pas réunies. Le désir n’était peut-être pas le leur.
Lorsque l’appel a été ouvert à des adultes handicapés, les réponses sont arrivées immédiatement.
J’ai alors compris que, même si l’œuvre était née d’une réflexion sur l’enfance, elle appelait en réalité des adultes. Elle s’adressait à celles et ceux qui avaient déjà vécu, perdu, traversé des expériences, et qui portaient une mémoire.
L’enfance est donc restée comme une origine symbolique —
mais l’œuvre a trouvé sa voix auprès des adultes.

Dans Sottobosco, tu interroges la manière dont les corps handicapés sont traités et intégrés dans la société. Comment perçois-tu cette situation aujourd’hui ?
C’est une question difficile, car la situation varie énormément selon les contextes.
Elle change d’un pays à l’autre, d’une ville à l’autre, entre le Nord et le Sud, entre les centres et les périphéries. Même au sein de l’Europe, qui revendique des valeurs et des cadres communs, les écarts restent immenses.
Il n’existe pas de véritable « moyenne ».
Ce que je sais, c’est que les personnes handicapées ne devraient pas être un «sujet». Nous ne devrions pas être un point inscrit à l’agenda politique.
Nous devrions simplement faire partie de la société.
Et pourtant, nous restons marginalisées.
Dans tous les pays européens où j’ai travaillé — de la Finlande prospère à l’Italie plus fragile — j’ai retrouvé le même sentiment : des réponses toujours insuffisantes, des systèmes qui ne nous incluent jamais pleinement.
L’une des lignes de fracture les plus profondes reste celle de la classe sociale.
Lorsque je parle avec des personnes handicapées disposant de ressources économiques importantes, j’entends un récit. Lorsque je parle avec celles qui en ont moins, j’en entends un autre.
L’accès, la dignité, la visibilité demeurent profondément conditionnés par le privilège économique.
Et partout en Europe, l’absence des personnes handicapées dans la vie publique reste frappante :
peu d’artistes,
peu de responsables politiques,
peu de figures publiques,
peu de corps visibles.
Même dans les pays dotés de systèmes de protection sociale solides, la marginalisation persiste. C’est le paysage dans lequel nous continuons d’évoluer.
Que signifie, pour toi, être en scène – au plateau en tant que corps handicapé aujourd’hui en Europe ?
Avant toute chose, cela signifie travailler.
Cela signifie exercer une profession choisie, pour laquelle j’ai étudié, que j’ai désirée et construite dans le temps. Pouvoir subvenir à mes besoins, contribuer économiquement à ma famille grâce à mon propre travail.
Rien de tout cela n’est évident pour une personne handicapée. Et, en tant qu’artiste, cela implique une responsabilité constante.
Nous sommes encore très peu nombreuses et nombreux. Encore moins issus du sud de l’Europe. Encore moins d’Italie.
Et plus rares encore celles et ceux qui revendiquent une place d’autrice ou d’auteur, et pas seulement d’interprète — qui refusent d’être réduits à la catégorie de « danseurs handicapés ».
Je ressens donc une forte responsabilité, simplement parce que cet espace s’est ouvert pour moi. Mais je sais que je ne serai pas là éternellement. Un jour, j’arrêterai. Je me fatiguerai. Je vieillirai. Mes projets évolueront. Je disparaîtrai.
Et tout ce qui aura été accompli n’aura aucun sens
si cela n’a pas produit de changement.
Pour moi, le changement est très concret. Lorsque je cesserai de travailler, il devra y avoir bien plus de personnes handicapées dans le domaine artistique qu’au moment où j’ai commencé.
Si mon parcours — et celui d’autres personnes comme moi — a un sens, ce sera parce qu’il aura ouvert des portes pour d’autres.
Sinon, il n’aura servi à rien. Et ce serait profondément triste.

As-tu le sentiment que ton travail contribue à modifier le regard porté sur les corps rendus invisibles ?
Aujourd’hui, mon travail s’inscrit aux côtés de nombreuses autres œuvres, portées par d’autres artistes, mais aussi par des livres, des essais et des voix critiques. Je me perçois comme faisant partie d’un mouvement plus large, d’un élan qui traverse l’Europe.
Ce qui compte pour moi, ce n’est pas tant la direction de ce déplacement que le fait qu’il ait lieu. Que quelque chose se mette en mouvement. Que quelque chose commence à se fissurer.
Pendant longtemps, les corps handicapés ont été soit absents de certains espaces, soit confinés à des « projets spéciaux » — souvent pensés par des personnes non handicapées, qualifiés de sociaux ou de thérapeutiques, et rarement considérés comme pleinement professionnels.
Nous sommes en train de défaire cela.
Nous rappelons que les corps handicapés existent. Que nous sommes là. Que nous pouvons être artistes, architectes, médecins — tout.
Que nous pouvons produire de la pensée, de l’identification et de l’émotion, y compris pour des publics non handicapés.
Que nous pouvons devenir moins exotiques, moins extraordinaires.
Un signe discret mais révélateur de ce changement apparaît dans les médias : de plus en plus, les articles cessent de décrire mon corps en détail. Ils mentionnent simplement que je suis une artiste handicapée — puis ils parlent du travail. De la pièce. De ce qu’elle dit.
Comment te protèges-tu émotionnellement lorsque ton corps et ton histoire personnelle sont si présents sur scène ?
C’est une question difficile.
Pour moi, la protection passe par l’expérience au plateau.
Par un entraînement constant — en particulier somatique — et par la rigueur.
Lorsque je parle de rigueur, c’est aussi de cela qu’il s’agit.
Dans des pièces comme Gentle Unicorn, la relation au public est extrêmement intense. Je rencontre les regards des spectateurs.
Je reste dans leur champ visuel.
Et de nombreuses émotions me traversent.
La protection repose alors sur un travail technique très précis : définir les durées, choisir les qualités de regard, savoir quand je dois revenir à moi, quand me fermer, quand m’ouvrir.
C’est un savoir-faire rigoureux, acquis avec le temps et l’expérience.
Dans Sottobosco, l’exposition fonctionne différemment. Parce que je porte une responsabilité envers les autres — les interprètes, les participants — je consacre beaucoup d’énergie à créer des conditions de sécurité. Et, ce faisant, je me protège aussi. Lorsque nous prenons soin les uns des autres, la vulnérabilité devient partagée, et donc plus légère.

Si tu pouvais redéfinir la danse à partir de ton expérience, quelle serait-elle ?
Je ne souhaite pas redéfinir la danse elle-même.
Pour moi, la danse est ce qui advient dans la relation entre le corps, l’espace et le temps. C’est le mouvement qui est généré quand les 3 se rencontent.
Cet espace existe déjà, et il est suffisant.
Ce que je voudrais remettre en question, c’est l’idée que toutes les formes de danse seraient déjà écrites, que tout ne serait que répétition, adaptation ou dérivation.
Les personnes handicapées commencent aujourd’hui à explorer véritablement la danse — non pas parce que nous étions absentes auparavant, mais parce que nous affirmons désormais que nous ne voulons plus seulement adapter des styles existants à nos corps.
Nous voulons repenser la danse à partir de nos corps.
Se demander : quels types de mouvements, de savoirs, de beautés peuvent émerger de là ?
Je ne cherche pas un nouveau nom. Je cherche de nouvelles approches.
Des approches qui ne considèrent pas les interprètes handicapés comme des nouveaux arrivants, ni comme des traducteurs d’un langage déjà existant.
« Je veux une danse qui naisse de nos corps
et qui, un jour, sera aussi étudiée, explorée et dansée par celles et ceux qui ne partagent pas notre expérience.«

Propos recueillis par Dorothée de Cabissole.
Interview réalisée en partenariat avec le Festival Everybody 2026 – Carreau du Temple.
Dorothée de CabisSole
Dorothée est la fondatrice du podcast Tous Danseurs.
Après une première vie professionnelle bien remplie, elle a décidé de mettre son énergie et ses savoir-faire au service de la danse.
Vivre ses rêves et être en mouvement.
Le beau, la culture, les arts vivants sont essentiels. Nous avons tous un rôle à jouer.
Voir tous ses articles
Partager ce podcast
Partager cet article