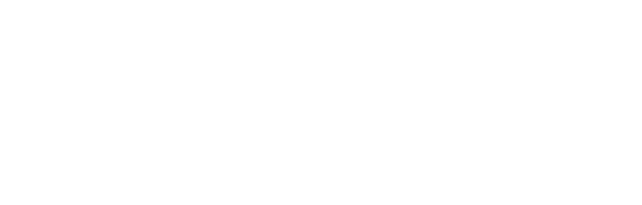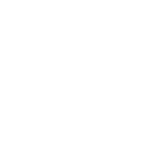Le solo autobiographique
Partie 4 : un éternel inachevé ?
Crédits photo : Pierre Planchenault (Chronic(s) 2, Hamid Ben Mahi)
LECTURE
10 min
DATE
PAR
Partager cet article
Cet article est né de mon attrait particulier pour le solo autobiographique. J’aime l’idée qu’il brouille la frontière entre le jeu et le je, dans la mesure où le corps qui performe, qui se met en scène, est en même temps celui qui dit vrai. Puis, les questionnements sont venus : qu’est-ce qu’un solo autobiographique, au fond ? Est-ce seulement un « récit rétrospectif » qu’un sujet fait de lui-même, ou bien a-t-il d’autres enjeux, notamment en ces temps de révolution féministe et de revendication d’une identité plurielle ? A quel(s) besoin(s) répond-il pour un.e chorégraphe-danseur.se ?
Pour tenter de répondre à ces questions, cet article, fondé sur des études de cas, va se diviser en quatre parties et mêlera analyses et fragments d’entretiens que j’ai menés avec trois chorégraphes-danseur.ses de solos autobiographiques. Il s’agit de Nadia Larina (Cie FluO), pour son solo de danse contemporaine La Zone (2018), d’Hamid Ben Mahi, chorégraphe et danseur de hip-hop (Cie Hors Série), pour son autobiographie en deux volets, Chronics (2001) et Chronic(s) 2 (2021), et enfin de Leïla Ka (Cie Koka), pour ses deux solos percutants Pode Ser (2018) et Se faire la belle (2022).
Le solo autobiographique, un éternel inachevé ?
Dans cette dernière partie, il s’agirait d’observer le devenir du solo autobiographique une fois qu’il a été créé et performé. Est-il simplement l’histoire d’une fois ou fait-il naître l’envie chez les chorégraphes-danseur.ses de se raconter à nouveau ? Continue-t-il de vivre et de se transformer avec le temps ?
Nadia confie ainsi que La Zone a créé une telle résonnance en elle, un tel accomplissement, qu’elle n’envisageait pas nécessairement un « après », comme si cette création pouvait être l’œuvre d’une vie à elle seule : « J’en avais peut-être envie inconsciemment, mais je pense que je ne le cherchais pas nécessairement. » Il y avait quelque chose d’apparemment complet dans ce solo : tout, ou presque, avait été dit, au point qu’« il aurait pu être décliné en cinq spectacles », reconnaît à présent la chorégraphe.
Et pourtant. Le solo autobiographique, on y revient. Bien qu’une création ne soit jamais vraiment clôturée aux yeux d’un.e chorégraphe, le solo, en particulier, semble avoir quelque chose en lui qui ne cesse de se réactiver, de se réactualiser.
LECTURE
10 min
DATE
PAR
Partager cet article
Par exemple, pour Nadia, La Zone n’a pris pleinement son sens qu’après coup, plus tard, par rétrospection. En effet, lors du processus de création, la chorégraphe ne s’est pas rendu compte à ce moment-là qu’elle donnait naissance, accidentellement, à un solo féministe, qui s’élevait contre l’oppression du patriarcat. C’est donc après coup, par le regard d’autres qui ont posé des mots sur La Zone, mais aussi à travers ses créations postérieures, affichées comme résolument politiques, féministes, queer, que Nadia a compris la teneur, jusque-là en latence, de sa première pièce. C’est par les floraisons, autrement dit Muage (un duo) et Every drop of my blood (un trio), qu’elle a saisi que La Zone en était le germe. De ce fait, le solo autobiographique embrasse a posteriori pleinement sa place au sein de l’œuvre de la chorégraphe : celle-ci qualifie maintenant La Zone de « solo féministe », appartenant à un triptyque dont le « point de jonction » est « la déconstruction du formatage hétéronormatif de la société ».

C’est après coup également que Leïla peut dessiner les contours de Pode Ser, et lui trouver une place, un sens, par rapport à ses deux autres créations, qui creusent elles aussi « les questions de l’empêchement, de la liberté » : tout comme chez Nadia, la notion de triptyque thématique n’apparaît que rétrospectivement pour Leïla, dans la mesure où elle ne l’avait « jamais prémédité ». Chez elle, cette idée de relecture du solo se manifeste donc tout autant, mais sans cette dimension de l’accident que comporterait La Zone pour Nadia.
Si Leïla avait en effet bien conscience de la teneur féministe et revendicatrice de Pode Ser lorsqu’elle l’a créé, c’est uniquement a posteriori qu’elle peut en préciser la couleur, le caractère, par comparaison avec Se faire la belle : « Je pense que dans mon deuxième solo, il y a quelque chose de plus radical, avec ce parti pris de ne jamais décoller mes pieds du sol, et de plus ‘mature’ aussi peut-être, que dans Pode Ser. Celui-ci me semble plus facile, plus accessible, même dans le costume, qui est très simple puisque je porte une robe avec des baskets.»

Du côté d’Hamid, Chronic(s) se relit à travers la continuité offerte par Chronic(s) 2, chacun mettant l’autre en perspective. Le chorégraphe peut ainsi (re)qualifier le premier chapitre en le comparant avec le deuxième : « Dans l’ensemble, je sens que ce sont deux pièces différentes : la première contient plus de jeu et d’humour, avec ce côté stand-up, tandis que la deuxième me semble plus sérieuse. ». Aussi, du point de vue du fond, le contexte autant que le propos de Chronic(s) 2 permet d’affirmer le caractère passé, révolu de ceux de Chronic(s) : « Avec Chronic(s) 2, je me rends compte que j’ai dépassé la question du racisme, dont j’ai été victime, qui imprégnait vraiment le premier volet. ».
En somme, à travers ces trois cas, il apparaît que le premier solo autobiographique n’est jamais achevé : même après avoir été joué, il se rejoue à travers les créations qui lui sont postérieures. Son sens ne cesse de se préciser, de se dévoiler, de se renouveler.
“Dans le solo, il faut être honnête avec soi-même. On est seul.e face à soi, donc on ne peut pas tricher ni se cacher.”
Leïla ka
La question de la relecture peut être poussée encore plus loin dans le cas d’Hamid, dans la mesure où, récemment, ce dernier rejouait – littéralement cette fois-ci – son premier solo en amont des représentations de Chronic(s) 2. Il faut souligner le caractère assez inédit de cette proposition, par laquelle deux créations, qui ont de surcroît vingt ans d’écart, s’enchaînent au cours d’une seule soirée. Pour le chorégraphe-danseur, c’est un « véritable challenge », qui trouve largement son public, celui-ci soulignant l’aspect « complémentaire » et « jouissif » de cette double représentation. Dans ce cas-là, la relecture de Chronic(s) se situerait sur deux niveaux : celui de la narration et celui de la chorégraphie elle-même. En effet, d’une part, rejouer un solo vingt ans plus tard implique, presque paradoxalement, une collision autant qu’une collusion temporelles : « Chronic(s) avait son époque. Quand je le joue aujourd’hui, on perçoit très clairement que je parle des années 2000. Les choses ont évolué depuis. Malgré cela, le solo peut encore se jouer car il résonne toujours autant. », remarque le danseur. Autrement dit, bien que reconnu comme daté, délimité dans le temps, le propos de Chronic(s) transcende les époques pour continuer de parler au présent, de poser des questions intemporelles dans lesquelles chacun se reconnaît. D’autre part, le deuxième prisme, plus palpable, par lequel le premier solo se relit serait le corps lui-même : « Je ne peux pas le danser comme en 2001 », souligne Hamid. Ainsi, la pièce de 2001, quoique rejouée à l’identique en 2022, est pourtant un peu autre dans la mesure où un de ses médiums, à savoir le corps, a évolué, s’est transformé, s’est imprégné de nouvelles traces. Il se fait « corps-temps », c’est-à-dire qu’il porte en lui, de manière tangible, l’écart temporel qui sépare les représentations de Chronic(s). En d’autres termes, ce premier solo s’éprouve différemment en 2022, il vit et se modifie au rythme du corps qui le danse, de sorte qu’il ne se fige pas dans le temps.

Plus largement, c’est en tant que genre chorégraphique qu’on revient au solo autobiographique, comme s’il appelait une continuation, suscitait une envie de poursuivre l’écriture de soi, de rédiger les autres chapitres d’une vie (dansée) qui a gagné, entre temps, en expérience, en créations, en maturité. Le solo autobiographique a quelque chose de cyclique, de « récurrent » souligne Nadia, comme s’il répondait au besoin régulier de se retourner sur soi. Nadia souhaite en créer un deuxième bientôt pour tenter, cette fois-ci, une « performance » : « J’ai besoin de partir sur quelque chose où je ne sais pas ce qui va se passer », dit-elle en faisant référence à son besoin habituel de « tout contrôler ». Ce caractère régulier serait donc nuancé par celui de la prise de risque, du défi lancé à soi-même : il s’agit de ne pas se raconter de la même manière, d’innover du point de vue de la forme, d’explorer de nouveaux possibles chorégraphiques et artistiques.
Cette cyclicité se manifeste de manière sensible surtout chez Hamid et Leïla. Pour le premier, vingt ans séparent donc Chronic(s) de Chronic(s) 2, entre lesquels s’intercale un autre solo autobiographique, Faut qu’on parle (2006), « complètement différent » dans son approche selon le chorégraphe. Vingt ans qui paraissaient nécessaires à ses yeux, comme un temps de « patience », de respiration, de maturité, pour mieux appréhender le deuxième chapitre, qui aurait eu « moins de sens s’il était venu peu de temps après le premier ». Vingt ans d’apprentissage aussi, où il s’agit pour Hamid de se tourner vers d’autres pratiques de danse, pour « essayer de déconstruire les automatismes figés en [lui] », pour fluidifier et enrichir sa patte chorégraphique, et ainsi densifier et complexifier le récit de soi dans son autobiographie. Enfin, vingt ans remplis d’autres créations, qui influencent, de manière plus ou moins explicite, le travail sur Chronic(s) 2, et qui, peu à peu, le font advenir, construisent et délimitent son propos – par exemple, Hamid savait qu’il n’avait pas envie de prendre la même direction que dans Faut qu’on parle, ni « de partager à nouveau certaines choses racontées dans ce solo-là ».
Avant un troisième volet, sûrement : « Je suis imprégné par cette prise de parole sur scène par laquelle on peut se raconter. C’est pourquoi il y aura sans doute un Chronic(s) 3 plus tard. », confie-t-il. Le solo autobiographique serait comme un récit-fleuve de soi-même, où le corps s’observe dans ses transformations, se fait sujet autant qu’objet d’une réflexion sur la traversée des années. Comme chez Hamid, bien que le laps de temps soit moins long, on retrouve chez Leïla ce besoin de se nourrir différemment, de tenter d’autres voies, entre chaque solo. En effet, Pode Ser lui a donné l’envie de creuser davantage les questions soulevées, l’envie de « s’élargir », de « partager », selon ses termes, autrement dit de penser et créer un travail à plusieurs cette fois – d’où la naissance d’un duo, C’est toi qu’on adore, en 2020. Ce serait comme si le solo avait posé des jalons, avait permis à la chorégraphe d’amorcer une réflexion qui aurait besoin d’autres moteurs, d’autres créateur.ices, pour être approfondie. D’ailleurs, créer pour plusieurs interprètes relève du « défi » pour Leïla, d’une sorte de mise à l’épreuve de soi, que viendrait assouplir, par la suite, le retour au solo, à « sa facilité et à sa liberté ». Plus encore, revenir au solo signifierait prendre un rendez-vous avec soi-même, se regarder régulièrement dans le miroir pour répondre de soi, pour se réajuster, se scruter sans complaisance, remettre le je à nu pour mieux composer à partir de lui : « Dans le solo, il faut être honnête avec soi-même. On est seul.e face à soi, donc on ne peut pas tricher ni se cacher. », analyse Leïla, forte de ses deux expériences. Ainsi, après une pièce de groupe à laquelle elle est en train de penser, « c’est fort possible » que la chorégraphe revienne au solo par la suite, me glisse-t-elle.
En somme, ce serait parce qu’il revient que le solo autobiographique ouvre la voie aux tentatives audacieuses et aux réinventions de soi. Surtout, il ne cesserait de conjuguer rétrospection – retour sur soi, sur ses précédentes créations – et progression – dépassement de soi, creusement de ses possibilités physiques et créatrices –, pour mieux raconter au présent un je qui n’a jamais fini de se réactualiser et de se densifier.
Partager cet article
HANNA LABORDE
Hanna est diplômée d’un Master 2 de Lettres modernes, future journaliste culturelle. Bordelaise depuis toujours, elle cultive un Amour infini pour les mots. Passionnée par la culture sous toutes ses formes et en particulier les arts vivants, elle chronique les spectacles, les livres et les interviews d’artistes pour plusieurs magazines culturels (Happen, Traversanne). Les salles de spectacle sont sa (deuxième) maison.
Voir tous ses articles