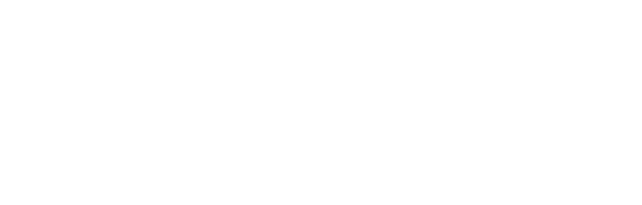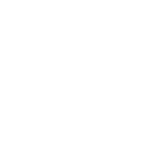Le solo autobiographique
PARTIE 1 : l’entrée en je(u)
Crédits photo : Yoann Bohac (Pode Ser, Leïla Ka)
LECTURE
6 min
DATE
PAR
Partager cet article
Cet article est né de mon attrait particulier pour le solo autobiographique. J’aime l’idée qu’il brouille la frontière entre le jeu et le je, dans la mesure où le corps qui performe, qui se met en scène, est en même temps celui qui dit vrai. Puis, les questionnements sont venus : qu’est-ce qu’un solo autobiographique, au fond ? Est-ce seulement un « récit rétrospectif » qu’un sujet fait de lui-même, ou bien a-t-il d’autres enjeux, notamment en ces temps de révolution féministe et de revendication d’une identité plurielle ? A quel(s) besoin(s) répond-il pour un.e chorégraphe-danseur.se ?
Pour tenter de répondre à ces questions, cet article, fondé sur des études de cas, va se diviser en quatre parties et mêlera analyses et fragments d’entretiens que j’ai menés avec trois chorégraphes-danseur.ses de solos autobiographiques. Il s’agit de Nadia Larina (Cie FluO), pour son solo de danse contemporaine La Zone (2018), d’Hamid Ben Mahi, chorégraphe et danseur de hip-hop (Cie Hors Série), pour son autobiographie en deux volets, Chronic(s) (2001) et Chronic(s) 2 (2021), et enfin de Leïla Ka (Cie Koka), pour ses deux solos percutants Pode Ser (2018) et Se faire la belle (2022).
L’entrée en je(u)
Dans les trois cas observés, la création d’un solo autobiographique se produit au début du parcours de chorégraphe, jusqu’à en marquer souvent l’ouverture. Il semble porter en lui une double dynamique de rétrospection et de projection : il s’agit de se raconter pour mieux se présenter, se retourner sur soi pour mieux se faire advenir, voire pour envisager un futur en tant que chorégraphe. Le solo autobiographique est, en quelque sorte, une « carte de visite », selon Nadia, à la fois archive de soi et premier jalon d’une identité chorégraphique en devenir. Cela dit, chez les trois chorégraphes-danseur.ses, la question du hasard surgit à chaque fois : l’idée d’une pièce autobiographique est souvent due à une rencontre déterminante, une proposition inspirante qui fait naître, par la suite, une envie de la poursuivre par soi-même.
Pode Ser de Leïla Ka a vu le jour grâce à une alliance du hasard et de la nécessité. Le hasard a pris la forme d’une chance, celle d’« avoir eu un studio pour créer ». La nécessité, c’était celle « d’avoir un espace pour se libérer des carcans qui nous contraignent » et pour « raconter des histoires ». Et puis tout est parti de cette robe rose, que porte Leïla dans ce premier solo, qui rappelle celle d’une princesse.
LECTURE
6 min
DATE
PAR
Partager cet article
“Je joue avec plusieurs personnages : ce qu’on est réellement, ce qu’on rêve d’être et ce qu’on doit être. ”
Leïla ka
Pour Nadia, si le choix d’un solo s’est d’abord imposé pour une raison pratique alors qu’elle venait de fonder sa compagnie trois ans plus tôt, il conjugue surtout, tout comme chez Leïla, hasard et nécessité. La Zone doit ainsi son existence autant à une proposition de créer une pièce de cinq minutes pour une soirée artistique autour de la Russie, qu’à un besoin naissant chez la danseuse de « [s]’exprimer, de montrer qui [elle est], de rechercher [s]on être ».
Le solo revêt aussi une dimension de défi, à savoir l’entrée reconnue dans le monde de la création chorégraphique : « Je me disais que si j’arrivais à faire un solo qui me plait autant qu’il plait autour de moi, je pourrais aller plus loin. », confie-t-elle.

Quant à Hamid, c’est d’abord le hasard d’une rencontre qui l’a mené à la création de Chronic(s) en 2001. Un an plus tôt il fondait sa compagnie et il était alors animé par une « soif d’apprendre ». Il croise ainsi le chemin du metteur en scène et chorégraphe Michel Schweizer, dont le travail s’articule autour de l’alliance de la danse et des mots. Celui-ci demande à Hamid, pour une performance, de prendre la parole sur scène, ce qui relevait d’une première pour lui. Cette expérience est décisive pour la naissance à venir de Chronic(s), dont la forme, qui mêle danse et parole, était « novatrice à cette époque-là », souligne le chorégraphe. Ce qui intéresse précisément ce dernier, c’est l’« impact » et la portée significative des mots prononcés sur scène lorsqu’il s’agit, pour un danseur, de se raconter : « Lorsqu’on prend la parole et qu’on se présente, on est alors identifié, dans le sens où le spectateur ne lit pas seulement le corps […], il entend aussi la couleur de la voix, ce qui marque plus facilement son esprit quant à la connaissance qu’il a de mon histoire. » Ainsi, selon Hamid, puisque les mots contextualisent et racontent, la danse, quant à elle, n’est plus nécessairement contrainte d’être située, de fournir des « repères » pour la compréhension du spectateur, et peut ainsi être « brute et un peu sauvage », plus livrée à elle-même, plus organique peut-être.
De quel « soi » parle le solo ?
Si l’on s’en tient à la définition originale de l’autobiographie, celle-ci reconstitue la genèse d’un être, qui repart sur ses traces, fait lumière sur ce qui l’a constitué, l’a forgé. Dans ce cas, le passé se remémore et s’interprète au présent de l’écriture, ce qui, nécessairement, le modifie. Ainsi, dans le solo autobiographique, le mouvement se fait écriture et part à la recherche du passé, réactualise les événements d’une vie autant qu’il les fictionnalise quelque peu. Cela dit, si le solo autobiographique offre une re-présentation du passé, il appelle aussi une projection de soi – ne serait-ce que lorsque le sujet s’inquiète de son futur, comme dans Chronic(s) 2 où Hamid s’interroge sur son avenir en tant que chorégraphe et danseur. Cette idée est particulièrement visible chez Nadia et Leïla, dans la mesure où leurs solos racontent aussi un corps qui tente de s’extirper des normes et des conditionnements qui l’ont modelé jusqu’à présent, afin de tendre vers leurs identités multiples. Nadia cite à ce sujet le philosophe Paul B. Preciado, pour qui « nous sommes obligés de faire appel à nos identités conventionnelles, masculine ou féminine, pour construire nos identités dissidentes ». Autrement dit, il s’agit de montrer, de convoquer ce qui empêche et contraint le corps, de composer avec pour mieux s’en libérer, et ainsi faire advenir nos propres identités. Par exemple, Nadia ne peut nier son apparence de femme – renforcée dans La Zone par le foulard traditionnel russe qu’elle porte –, elle ne peut effacer son histoire vécue en tant que femme. Mais c’est précisément lorsqu’elle les met en scène que la danseuse fait surgir une « explosivité » qualifiée de « virile » (bien qu’elle n’aime pas vraiment l’étiqueter ainsi), qui plus est, vêtue d’un costume unisexe.
Quant à Leïla, ses deux solos mettent en scène une tentative d’extirpation des schémas archaïques, patriarcaux, pour un à-venir possible. Le solo autobiographique ne parle pas tant ici d’un soi passé, mais d’un soi au présent et de ses aspirations, qui cherche à se faire multiple, délesté de ses entraves : « Je joue avec plusieurs personnages : ce qu’on est réellement, ce qu’on rêve d’être et ce qu’on doit être. », souligne la chorégraphe. Ainsi, chez Leïla, les injonctions, qui traversent les siècles, s’entrechoquent avec les luttes, qui ne perdent jamais leur actualité.
Autant dans Pode Ser que dans Se faire la belle, ces conditionnements, ces stéréotypes, ces « identités conventionnelles » donc, sont notamment matérialisés par les costumes. La danseuse en fait un usage signifiant en se servant des représentations symboliques qu’ils ont toujours véhiculées : dans son premier solo, elle porte une robe rose de petite fille, et dans le deuxième, une longue chemise de nuit blanche qui rappellerait une camisole. Chacune traduit l’enfermement de la femme dans un carcan, une image figée, que la danse vient déjouer par contraste. Le mouvement se veut rageur, explosif, tendu, heurté autant qu’ample, pour marquer ces multiples tentatives de libération du corps, aussi vaines que fructueuses.
Ainsi, dans ce cas-là, le solo autobiographique pourrait matérialiser ce processus d’émancipation en action, voire en être le moteur : il raconte et expose les « identités conventionnelles », qui imprègnent le corps, autant qu’il tend, par le mouvement, à façonner les « identités dissidentes », à les faire advenir et les revendiquer. Il serait presque comme un espace de transition, qui met en scène autant qu’il acte le passage d’un conditionnement à une libération, de la norme à la dissidence.

Enfin, il s’agirait de penser le solo autobiographique comme l’espace de création d’un hors-temps, où le soi se dilate en quelque sorte. Plus précisément, l’autobiographie pourrait se comprendre en négatif : se raconter signifierait aussi danser notre non-vécu, le non-advenu, ce que Georges Gusdorf appelle notre « cheminement second », celui situé « par-delà le sillage objectif du CV ».
Ainsi, c’est dans Chronic(s) 2 qu’Hamid confie s’être rendu compte qu’il était « passé à côté de la danse traditionnelle de [s]es parents en n’ayant pas fait la démarche de l’explorer ». Il partage ainsi avec le public son interrogation sur ce « rejet », et intègre alors des mouvements de danses orientales à sa création, en guise de réparation peut-être, mais aussi d’enrichissement de sa propre patte chorégraphique – un geste qu’Hamid avait déjà initié avec sa précédente pièce pour six danseurs, Yellel (2019). L’autobiographie devient ainsi le lieu où l’on met en scène ce qu’on n’a pas fait, où l’on corrige nos oublis par le fait même qu’on les interroge et les comble, de sorte que l’identité continue de se forger, de s’enrichir et s’interroger au présent de l’écriture du solo.

Quant à Leila, elle met en scène dans Pode Ser – dont le titre signifie « peut-être » en portugais –, tous ses soi qui ne le sont pas et auxquels elle aspire. « Quand je me raconte dans un solo, je suis toujours un peu autre. », précise-t-elle ainsi. Par le mouvement, il s’agit de donner matière à nos chimères et à nos utopies pour mieux densifier notre récit, de toucher à l’atemporel pour mieux s’ancrer dans le présent, de se faire personnage pour mieux s’approcher de soi-même. Cette idée se manifeste tout autant chez Nadia par son désir d’explorer, dans La Zone, le « flou entre le rêve et la réalité », le premier étant composé de nos « intuitions, d’émotions refoulées, de désirs non assouvis, de pulsions sexuelles », selon la chorégraphe. Celle-ci recherche cette zone de l’entre-deux et de l’en même temps, cet espace de liberté où se télescopent notre histoire indélébile et nos fictions inavouées, nos actes et nos indicibles, ceux-ci nous racontant tout autant, sinon plus peut-être, que ceux-là.
Cette réflexion se poursuit dans une deuxième partie qui traite du rôle des autres dans la création et la performance du solo autobiographique.
Sources :
– Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975, p.14.
– Podcast de Leïla Ka
– Georges Gusdorf, « De l’autobiographie initiatique à l’autobiographie genre littéraire » dans Revue d’Histoire littéraire de la France, Paris, Editions Armand Colin, n°6, 1975, p.971.
Partager cet article
HANNA LABORDE
Hanna est diplômée d’un Master 2 de Lettres modernes, future journaliste culturelle. Bordelaise depuis toujours, elle cultive un Amour infini pour les mots. Passionnée par la culture sous toutes ses formes et en particulier les arts vivants, elle chronique les spectacles, les livres et les interviews d’artistes pour plusieurs magazines culturels (Happen, Traversanne). Les salles de spectacle sont sa (deuxième) maison.
Voir tous ses articles