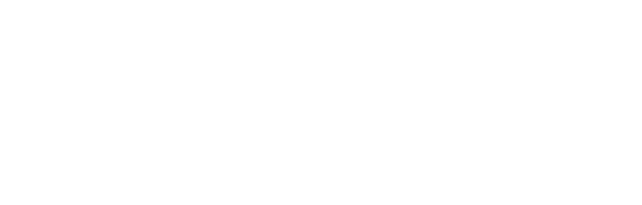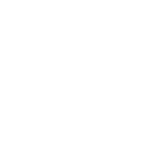Le solo autobiographique
Partie 3 : composer avec des archives
Crédits photo : Emmanuelle Derrier (La Zone, Nadia Larina)
LECTURE
4 min
DATE
PAR
Partager cet article
Cet article est né de mon attrait particulier pour le solo autobiographique. J’aime l’idée qu’il brouille la frontière entre le jeu et le je, dans la mesure où le corps qui performe, qui se met en scène, est en même temps celui qui dit vrai. Puis, les questionnements sont venus : qu’est-ce qu’un solo autobiographique, au fond ? Est-ce seulement un « récit rétrospectif » qu’un sujet fait de lui-même, ou bien a-t-il d’autres enjeux, notamment en ces temps de révolution féministe et de revendication d’une identité plurielle ? A quel(s) besoin(s) répond-il pour un.e chorégraphe-danseur.se ?
Pour tenter de répondre à ces questions, cet article, fondé sur des études de cas, va se diviser en quatre parties et mêlera analyses et fragments d’entretiens que j’ai menés avec trois chorégraphes-danseur.ses de solos autobiographiques. Il s’agit de Nadia Larina (Cie FluO), pour son solo de danse contemporaine La Zone (2018), d’Hamid Ben Mahi, chorégraphe et danseur de hip-hop (Cie Hors Série), pour son autobiographie en deux volets, Chronics (2001) et Chronic(s) 2 (2021), et enfin de Leïla Ka (Cie Koka), pour ses deux solos percutants Pode Ser (2018) et Se faire la belle (2022).
Composer avec des archives
Précédemment, je me suis intéressée à la place essentielle de l’autre dans la création et la performance du solo autobiographique. Il s’agirait maintenant d’observer les supports matériels mobilisés par les chorégraphes-danseur.ses pour façonner leur récit de soi. Ils et elles peuvent en effet utiliser des archives personnelles renfermant une mémoire, ou plus largement, des documents et des œuvres préexistants.
LECTURE
4 min
DATE
PAR
Partager cet article
Hamid fait appel à des archives majoritairement personnelles, qui soutiennent ce travail d’enquête sur soi. Qu’elles soient des photographies ou des objets, elles sont mises en jeu, incorporées à la création, dans une scénographie souhaitée « la plus accessible possible pour le spectateur », précise le chorégraphe – les images sont projetées sur un écran en fond de scène, par un vidéoprojecteur dans les deux solos, à quoi s’ajoutent, dans Chronic(s), quelques affaires à disposition dans un carton.
Au sujet des photographies en particulier, Hamid souligne qu’elles imposent une certaine autorité à l’œil du spectateur. En effet, par leur caractère signifiant, figé, indélébile, qui dit que « ça a été » pour reprendre la formule de Roland Barthes, elles assurent l’authenticité de l’histoire du chorégraphe : « Qu’il aime ou non, le spectateur est obligé d’accepter que ce soit mon histoire. L’image est un véhicule de sincérité, de valeur, mais aussi de connaissance de mon histoire puisqu’elle est un langage supplémentaire : si quelqu’un ne comprend pas ma danse, il pourra facilement rentrer dans mon univers grâce aux images. ». À l’inverse, la danse est intrinsèquement mouvante, fluide, donc plus insaisissable, appelant encore davantage l’interprétation du spectateur.

Nadia, quant à elle, utilise également des archives matérielles – des extraits d’enregistrements radiophoniques, qui servent, tout autant que la musique, de paysages sonores à la chorégraphie, mais aussi un journal, à la fois moteur dramatique et objet déclencheur du mouvement de la danseuse. Surtout, Nadia travaille à partir d’œuvres, à savoir, la chanson du poète russe Vyssotski, Les chevaux fines bouches, le cinéma de Tarkovski et l’essai de Svetlana Alexievitch, La Supplication, dans lesquelles elle puise ce qui fait l’essence de cette « âme russe » qu’elle tente elle-même de mettre en scène. Il s’agit ainsi de s’inspirer d’une poétique, d’un parti pris créatif, de réinvestir des motifs – par exemple, la métaphore du bord de l’abîme chez Vyssotski pour dire cette tendance au déchirement entre des extrêmes présente chez les Russes, ce que traduisent notamment l’énergie explosive de la danseuse et les multiples ruptures de rythme. Le corps devient un medium tangible au même titre que les mots de Vyssotski et les images de Tarkovski, au travers duquel s’incarne l’impalpable « âme russe ». Par là même, le solo autobiographique se ferait non seulement œuvre, mais aussi archive de l’histoire d’un pays, d’une culture, de traits de caractère d’un peuple. La chorégraphe s’inspire également des surréalistes et du cinéma de Lynch pour travailler le flou entre le rêve et le réalité, cette « zone » de l’incertain, qui peut habiter autant l’intime que le collectif – le titre du solo, La Zone, fait en effet référence « aux villages touchés par la catastrophe de Tchernobyl », qui paraissent, aux yeux de la chorégraphe, plongés dans un entre-deux du rêve et de la réalité. « Mes mouvements partent vraiment des univers de ces artistes », confie Nadia : ils s’inspirent de leurs personnages et donnent forme à leurs atmosphères, comme ces rebonds du corps qui semblent nés d’une (im)pulsion, rappelant celles qui façonnent nos rêves.
Faire de son corps une archive
Si ces archives, ces documents tangibles, portent en eux une mémoire qui aide le ou la chorégraphe à se raconter, il ou elle écrit avant tout avec son corps. Or, ce dernier est aussi une matière qui se souvient au même titre que les archives, au point que l’on parle, dans les recherches sur la danse, de« corps-archive ». Autrement dit, le corps se fait réceptacle d’un passé, il recèle des traces signifiantes qui peuvent être lues et interprétées. « C’est comme les griots sénégalais, souligne Hamid, que l’on qualifie de ‘bibliothèques vivantes’. Dans mon cas, c’est un peu pareil : je raconte une histoire avant que ma mémoire ne s’efface. Mon corps donne de la force à ces souvenirs sur le plateau, et il porte en lui toutes ces années de travail, de rigueur. » Le corps témoigne ici d’une vie – d’humain, de danseur – qu’il met en mouvement sur le plateau, au fur et à mesure que les mots remontent le temps. Il est l’objet du récit dont il est tout autant l’auteur et le médium.
“Mon corps est porteur de l’histoire de mon pays et de ma famille, de l’oppression stalinienne, de traits de caractère propres au peuple russe”.
NADIA LARINA
Nadia note que cette notion de « corps-archive » est particulièrement sensible et opérante dans le solo autobiographique, dans la mesure où lorsqu’on crée pour plusieurs danseur.ses, « cela déforme la matière » selon elle : le caractère brut, intime, de chaque corps-archive s’altère au contact des autres.
Plus encore, en reprenant la formule de Paul B. Preciado, à savoir le corps comme une « archive politique vivante » – ou comme « somathèque» –, Nadia souligne l’héritage politique, culturel, familial dont elle est imprégnée : , de l’oppression stalinienne, de traits de caractère propres au peuple russe. » Le corps comme malle ouverte de nos souvenirs personnels, mais aussi comme territoire de nos luttes, cartographie de nos oppressions, tant intimes que collectives. Au sujet de ces dernières, Nadia ajoute que son corps, dans La Zone, raconte aussi les marques du poids du patriarcat, de la domination masculine (bien qu’elle n’en ait pas eu conscience à ce moment-là ; j’y reviendrai), qui conditionnent encore certains de ses gestes, ses actions et ses attitudes.

Elle rejoint ainsi le travail de Leïla sur ce point, pour qui le corps « est porteur des histoires de nos guerres silencieuses, de nos traumas ». Dans ses deux solos, la danseuse rend visible les conditionnements qui restreignent son corps, qui le rendent étranger à lui-même, autant qu’elle crie en mouvements ses tentatives de libération. « Nous sommes des maisons hantées par des plaintes dont on ne sait plus à qui elles appartiennent, mais qu’on a fait nôtres. », me glisse-t-elle dans notre conversation. C’est une phrase de la psychanalyste et philosophe Anne Dufourmantelle, extraite de son ouvrage Éloge du risque, qui résonne particulièrement chez Leïla. Ces « plaintes », la danseuse les métaphoriserait notamment par les contraintes qu’elle impose à son corps – garder ses bras pliés dans Pode Ser, ne pas décoller ses pieds du sol dans Se faire la belle. Ces contraintes disent un corps empêché, englué dans des normes dans lesquelles il ne se reconnaît pas. Tout l’enjeu est alors de puiser de la force, de l’énergie dans cette immobilité des membres, qui se font points d’ancrage, pour se débattre, frapper, s’extirper. Le corps est mis en scène de telle sorte qu’il exhibe, raconte visuellement et plastiquement, conjugue ses conditionnements avec ses combats pour s’en extraire.
Dans la dernière partie de cet article, j’envisagerai le solo autobiographique comme un éternel inachevé.
Sources :
– Dossier artistique de La Zone
– Susanne Franco, « Retracer une subjectivité dansante, repenser une histoire incorporée », dans Recherches en danse [En ligne], 7 | 2019. Disponible sur : https://journals.openedition.org/danse/2591
Partager cet article
HANNA LABORDE
Hanna est diplômée d’un Master 2 de Lettres modernes, future journaliste culturelle. Bordelaise depuis toujours, elle cultive un Amour infini pour les mots. Passionnée par la culture sous toutes ses formes et en particulier les arts vivants, elle chronique les spectacles, les livres et les interviews d’artistes pour plusieurs magazines culturels (Happen, Traversanne). Les salles de spectacle sont sa (deuxième) maison.
Voir tous ses articles